Notre article intitulé « IMPORTANCE CULTURELLE DES TOITS DE CHAUME« , que nous avons préparé en tant que Dök Mimarlık, a été publié dans le numéro 184 de juin 2025 du magazine TOKİ Haber!
📍 Publication : TOKI News – www.tokihaber.com.tr
📅 Numéro : Juin 2025 / Numéro 184
🎯 Institution : République de Turquie Ministère de l’environnement, de l’urbanisation et du changement climatique | Administration du développement du logement (TOKİ)
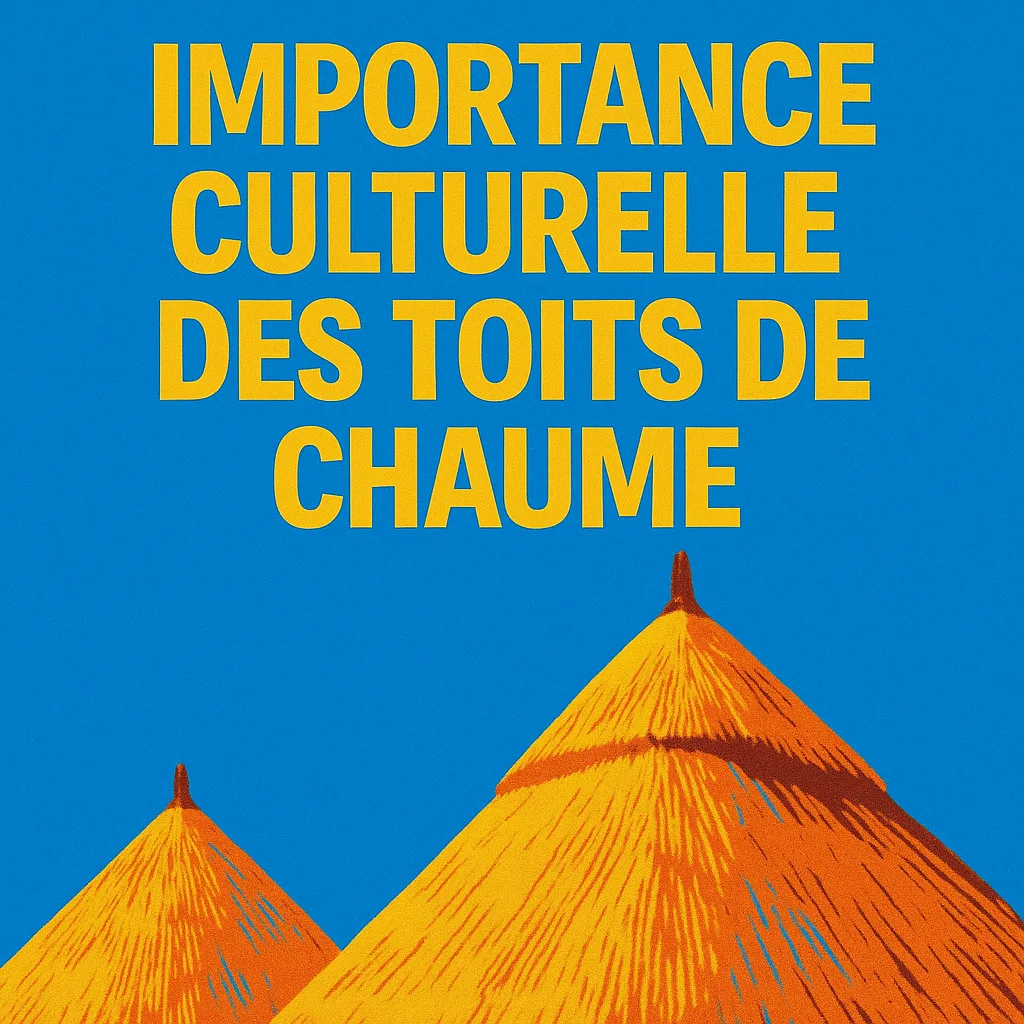
Dans cet article, nous avons examiné la place des toits de chaume traditionnels dans le patrimoine architectural d’un point de vue historique et culturel. Avec l’utilisation de matériaux locaux, la sensibilité au climat, les techniques artisanales et les exemples contemporains, nous avons souligné la façon dont le toit de chaume jette un pont entre le passé et le présent.
Cette publication revêt une grande importance pour nous. Nous pensons en effet que l’architecture ne se limite pas à la production d’espaces, mais qu’elle est aussi un mode de pensée, une mémoire culturelle et un récit ouvert à la transmission. Participer à une plateforme importante et institutionnelle telle que TOKİ Haber, transmettre des connaissances architecturales à une communauté plus large et représenter une approche centrée sur l’apprentissage, l’enseignement et le questionnement comme DÖK Architecture a été à la fois une source d’inspiration et une forte source de motivation pour nous pour l’avenir.
🎓 Nous continuerons à parler d’architecture, à poser des questions et à apprendre en partageant. Nous continuerons à contribuer à une culture architecturale plus inclusive, intellectuelle et critique grâce à nos publications.
✍️ Texte intégral de notre article :
IMPORTANCE CULTURELLE DES TOITS DE CHAUME
Expliquant les difficultés et les avantages de l’utilisation du chaume dans les constructions traditionnelles, Kağan Keçeci souligne que ces structures jettent un pont entre le passé et l’avenir en abordant les toits de chaume, qui reflètent la culture locale, offrent des espaces de vie pratiques, sont considérés comme un symbole de la vie pastorale et soutiennent une vie liée à l’environnement naturel, dans un contexte culturel.
Pouvez-vous nous parler de l’application des toits de chaume, qui ont été préférés comme type de toiture traditionnelle dans différentes régions géographiques pendant des siècles, dans un contexte historique ?
La toiture en chaume est l’une des plus anciennes techniques de construction locale, présente dans l’histoire architecturale de presque toutes les cultures du monde. On pense qu’elle a été utilisée dès l’Antiquité comme une solution pratique aux conditions environnementales locales. Des preuves archéologiques provenant d’anciennes civilisations, dont l’Égypte, la Mésopotamie et les premières colonies européennes, suggèrent que le chaume servait de couverture accessible, isolante et imperméable. Selon l’architecte Eduardo Souza, les recherches montrent que les structures en chaume sont apparues à l’époque où les populations sont passées du nomadisme à l’agriculture.
Historiquement, les sociétés ont utilisé des matériaux locaux et naturels tels que le chaume, la paille, l’herbe et les feuilles de palmier pour construire des toits qui répondent à des besoins fonctionnels et esthétiques. Au fil des siècles, le chaume a servi à de nombreux bâtiments comme solution de couverture accessible, abordable, locale et efficace dans des régions où le bois et la pierre sont limités ou inaccessibles. Dans l’Europe médiévale, le chaume est devenu la méthode de couverture des habitations rurales et des cottages, en particulier dans les îles britanniques où les matériaux locaux tels que la paille et le roseau étaient abondants. Des exemples historiques notables, tels que les toits de chaume des Cotswolds, témoignent de la continuité culturelle et de l’adaptation de cette technique au fil des siècles.

Cotswolds, Royaume-Uni
Bien que les matériaux de couverture industriels aient offert des solutions plus efficaces dans de nombreux bâtiments grâce aux progrès de la technologie et à l’impact de la révolution industrielle, ce produit pratique continue d’exister en tant que solution locale dans les zones rurales du monde entier.
UN PROCESSUS À LONG TERME
Quelles sont les difficultés rencontrées en termes d’utilisation du chaume dans les pratiques de construction traditionnelles, de techniques de construction et de main-d’œuvre ?
La construction et l’entretien des toits de chaume est un processus à long terme et à forte intensité de main-d’œuvre. Des ouvriers spécialisés travaillent deux par deux, attachant des paquets de chaume ensemble et poussant une aiguille en fil de fer de l’intérieur vers l’extérieur du bâtiment. Chaque couche est méticuleusement attachée et fixée pour assurer l’étanchéité, l’isolation et la durabilité. La forte pente (45° à 60°) observée dans la plupart des toits de chaume facilite l’écoulement de l’eau et empêche les infiltrations d’eau et le pourrissement. Une bonne ventilation est très importante pour permettre à l’humidité de s’échapper de la structure, ce qui prolonge la durée de vie du toit et réduit le pourrissement.
Un toit de chaume bien construit peut durer des décennies. À Kayabuki no Sato, au Japon, où 40 bâtiments aux toits de chaume sont protégés, on a observé que les toits de chaume doivent être remplacés tous les 20 ans pour protéger les structures.

Kayabuki no Sato, Japon
Lors des réparations, seuls des ouvriers qualifiés sont capables de retisser les couches sans qu’il y ait de fuites. Le feu constitue un autre défi dans la réparation des toits de chaume. Par nature, le chaume sec est hautement inflammable et les ouvriers doivent prendre des précautions à cet égard. Les codes locaux reconnaissent l’utilisation de systèmes d’arrosage (Miyama, Japon) ou de chaume traité pour réduire les risques d’incendie dans les bâtiments.
LES MATÉRIAUX UTILISÉS VARIENT D’UNE RÉGION À L’AUTRE
Les toits de chaume sont construits en empilant les uns sur les autres des matériaux végétaux locaux. Les ouvriers rassemblent des fagots de plantes sèches (paille, roseaux, feuilles de palmier, herbes, etc.) et les disposent vers le haut à partir de l’avant-toit, chacun au-dessus de celui qui se trouve en dessous, pour empêcher le passage de l’eau. Les matériaux utilisés varient également selon les régions.
Régions tropicales : Dans les régions équatoriales et du Pacifique, les feuilles de palmier nain ou de pandanus sont utilisées pour les toitures à Fidji et à Hawaï. À Bali, les fibres noires du palmier à sucre (ijuk) sont utilisées en particulier pour les toits des temples et des sanctuaires.

Ijuk, Bali
Régions tempérées : La paille de blé, d’orge et de seigle est courante. De longues couches superposées sont utilisées pour l’isolation et l’étanchéité à l’air. Dans le nord de l’Europe, la pente du toit facilite l’écoulement de la neige et de la pluie. Dans les régions tempérées, la paille de céréales est généralement collectée. En Angleterre, la paille de blé, appelée « longstraw », est positionnée séparément du « water reed », qui est collecté dans les marais.
Régions arides : Dans les déserts, des couches de chaume plus épaisses sont utilisées pour isoler contre les températures extrêmes et les changements de température, et des techniques de récupération de l’eau sont intégrées dans la conception du toit. En Afrique, les huttes rondes sont construites par un tressage complexe de paille ou d’herbe sur des poteaux en bois. En Afrique de l’Est, les huttes Kikuyu au Kenya sont tissées à partir d’herbes telles que Imperata cylindrica (alang-alang ) ou de feuilles de canne à sucre. La hutte iQukwane , typique du peuple zoulou en Afrique du Sud et dans les environs, est construite en pliant de minces poteaux en forme de dôme et en tressant des herbes autour, puis en attachant le chaume à l’aide de cordes enroulées pour assurer la stabilité de l’ensemble.

La hutte iQukwane
Pouvez-vous nous parler des avantages fonctionnels des toits de chaume ?
La structure épaisse et stratifiée du chaume crée beaucoup d’espace d’air, ce qui en fait un excellent isolant. Les maisons à toit de chaume restent chaudes en hiver et fraîches en été et nécessitent moins de chauffage et de climatisation. En cas de pluie, les couches extérieures retiennent rapidement l’eau, de sorte que le chaume à l’intérieur reste sec et conserve sa densité. Les recherches montrent que même dans les climats humides, la couche intérieure reste au-dessus du point de congélation et améliore le confort thermique.
Le chaume est beaucoup plus léger que les tuiles ou les toits métalliques, il réduit la charge structurelle et permet des formes architecturales flexibles. La caractéristique la plus importante du chaume est qu’il s’agit d’un matériau durable. Renouvelable et local, il a une empreinte carbone plus faible que les systèmes de toiture en tuiles ou en métal et peut être réutilisé.
SYMBOLE DE LA VIE PASTORALE
Je pense qu’il n’est pas faux d’associer les toits de chaume à la vie rurale pastorale, n’est-ce pas ?
Grâce à ses racines rurales et au fait qu’il s’agit d’un matériau local, le chaume est fortement associé au charme pastoral et à la tradition populaire. Dans l’art et la littérature, une cabane au toit de chaume avec ses avant-toits ondulés symbolise un mode de vie rural simple et la tranquillité.
Les chalets d’été sur le lac Balaton en Hongrie utilisent délibérément le chaume pour capturer le traditionalisme de l’architecture locale. En Afrique, les huttes de chaume construites avec des herbes locales offrent des espaces de vie pratiques à de grandes communautés tout en reflétant la culture locale. En Asie du Sud-Est, les structures en bambou et en palmier, courantes dans les villages ruraux, favorisent une vie liée à l’environnement naturel
. En Angleterre, les cabanes au toit de chaume sont considérées comme le symbole d’une vie idyllique.
Bien que les toits de chaume soient une technique de construction, ils ont également une histoire riche et une signification culturelle. Pouvez-vous parler de l’application des toits de chaume dans un contexte culturel ?
Le chaume est un héritage culturel dans de nombreuses sociétés. Au Japon, les maisons traditionnelles kayabuki ont un statut semi-spirituel. Le maître du toit de chaume Haruo Nishio décrit les structures de toit de chaume comme « un espace issu du néant… un lieu de culte… construit en remerciement à Dieu, à Bouddha et à nos ancêtres ». Les conseils internationaux du patrimoine mondial soulignent également souvent que le chaume est un élément important de notre identité historique.
On estime que les toits de chaume sont un élément caractéristique des bâtiments et qu’ils contribuent au caractère des villages et des zones rurales. Les couches de structures de toits de chaume vieilles de plusieurs siècles sont considérées comme des trésors archéologiques qui peuvent révéler la vie quotidienne et les techniques du passé. En termes d’impact culturel, les toits de chaume représentent notre passé, notre identité et la continuité de l’artisanat.
Comment évaluez-vous la relation entre les structures construites avec des matériaux locaux tels que les toits de chaume et l’environnement ?
Les toits de chaume sont directement liés à l’écologie locale. Des matériaux locaux sont utilisés dans les bâtiments. Les besoins climatiques déterminent la forme du toit. La pente du toit doit être planifiée en fonction des conditions environnementales. Dans les régions tropicales(climats de mousson), le toit est très long et très pentu. Grâce à cette pente, la pluie s’écoule rapidement du toit et l’air chaud intérieur monte et est expulsé de l’espace de vie. Les maisons philippines de style bahay kubo ou bahay-kalibo ont un toit en chaume de palmier très incliné avec de grands débords pour éviter les fortes chaleurs et les pluies diluviennes.

Bahay-Kalibo
Dans les régions enneigées du Japon, les maisons de style gasshō-zukuri ont des toits de chaume qui sont posés avec une pente de 60° pour éviter les charges de neige.
Le matériau des toits de chaume et la manière dont ils sont construits reflètent directement leur environnement. Par conséquent, les toits locaux doivent être conçus pour offrir une protection contre les conditions locales.
« LES TOITS DE CHAUME JETTENT UN PONT ENTRE NOTRE PASSÉ ET NOTRE AVENIR.
Comment expliquez-vous l’utilisation continue du roseau dans l’architecture contemporaine ?
Ces dernières années, le roseau a connu une renaissance. De nombreux pays prennent des mesures pour promouvoir cette technique. La région de Miyama au Japon a lancé des programmes touristiques(Countryside Stays initiative) pour préserver les maisons au toit de chaume en tant que musées vivants et proposer des expériences d’hébergement. En 2017, le bureau d’architecture danois Dorte Mandrup a choisi les toits de chaume pour la conception du Wadden Sea Centre, qui s’ouvre sur la mer des Wadden, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, afin d’établir un lien avec le patrimoine bâti de la région, démontrant ainsi la poursuite de l’écologie dans l’architecture moderne.

Centre de la mer des Wadden, Danemark
Les Pays-Bas perpétuent la tradition des toits de chaume. En dehors de l’Europe, de nombreux projets commerciaux (hôtels, pavillons de zoo, centres culturels) utilisent le chaume pour obtenir une esthétique « durable ». Des organisations de conservation telles que Historic England ont introduit des règles de planification qui encouragent l’utilisation du chaume dans certains bâtiments. Parallèlement à ces initiatives, les bâtiments historiques à toit de chaume sont soigneusement préservés.
Grâce aux efforts déployés d’hier à aujourd’hui, les toits de chaume constituent aujourd’hui un pont entre notre passé et notre avenir. Défiant le temps et témoin de notre évolution, le saz continue à nous servir non pas comme une pratique du passé, mais comme une valeur patrimoniale et un matériau réel et polyvalent auquel nous nous intéressons à nouveau.
Remerciements
Pour leurs précieuses contributions au sujet des « Toits de chaume » publiées dans le cadre du dossier d’actualité du numéro 184 de juin 2025 du magazine TOKİ Haber, et pour leurs études qualifiées sur le même sujet, je tiens à remercier les personnes suivantes qui ont éclairé le sujet par leurs articles i ntitulés « Patrimoine culturel et architectural de l’Irlande: Thatched Roofs« , qui éclairent le sujet par leurs articles :
Rümeysa Çılğasıt(ORCID & DergiPark)
Université de la Fondation Fatih Sultan Mehmet, Institut d’études supérieures, Département d’architecture, Programme de maîtrise en architecture
et
Maître de conférences. Prof Uğur Özcan(ORCID & DergiPark)
Université de la Fondation Fatih Sultan Mehmet, Faculté d’architecture et de design, Département d’architecture
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements aux éminents universitaires, à leur faire part de notre plaisir d’avoir contribué à une question de patrimoine culturel commun à partir de différentes perspectives, et à les féliciter pour leur travail.
Nous souhaitons également remercier l’éditrice Gül Demirdaşpour son intérêt, son soutien et sa coopération dans le processus de communication.
Bibliographie :
ArchDaily(2022, 14 janvier). Toits de chaume : Histoire, performances et possibilités en architecture.
ArchDaily(2024, 11 avril). Exploration des huttes indigènes d’Afrique : Le tissage comme architecture climatique et sociale.
BBC Travel(2023, 9 mai). McDonald, S. Les maîtres d’un métier vieux de 5 000 ans.
https://www.bbc.com/travel/article/20230518-the-masters-of-a-5000-year-old-craft
Countryside Stays Japan. Countryside Stays Japan. Agence japonaise du tourisme.
https://countrysidestays-japan.com/index.html
Dilley, C. (2015). Toits de chaume et façades ouvertes : Chickee architecture and its changing role in Seminole society. University Press of Florida.
https://doi.org/10.2307/j.ctvx06x3k
Keçeci, K. (2024, 12 décembre). Les toits de chaume dans l’architecture vernaculaire à travers le monde. Architecture en vrac.
https://dokmimarlik.com/fr/les-toits-de-chaume-dans-larchitecture-vernaculaire-du-monde-entier/
Keçeci, K. (2024, 29 novembre). Les couvertures de toit en chaume avec des applications modernes. Dök Architecture.
https://dokmimarlik.com/fr/les-couvertures-en-chaume-et-leurs-applications-modernes/
Mandrup, D., & Hjortshøj, R. Wadden Sea Center. Divisare.
https://divisare.com/projects/395006-dorte-mandrup-rasmus-hjortshoj-coast-wadden-sea-center
Miyama Navi. Kayabuki no Sato.
https://miyamanavi.com/en/sightseeing/kayabuki-no-sato
En savoir plus sur Dök Architecture
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
















