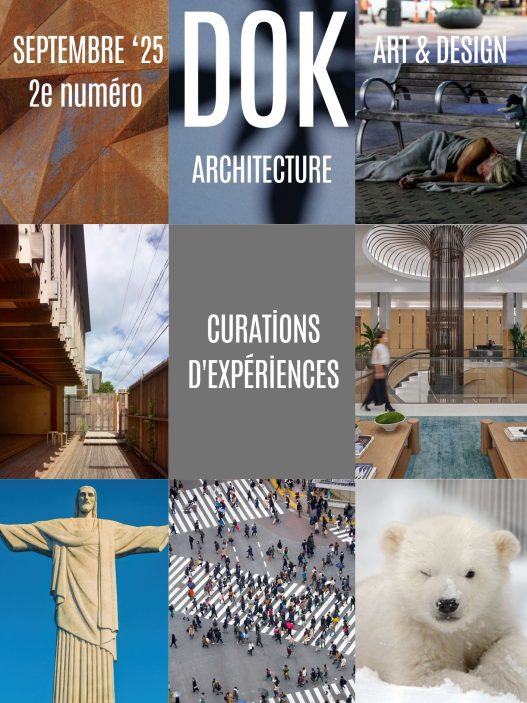Complexes de type E et calendrier agricole : Les ensembles du « groupe E » — plate-forme ouest et structures orientées vers l’est — forment un calendrier agricole en pierre intégré au tissu urbain maya. Ces complexes n’étaient pas des observatoires isolés : leurs axes centraux (ouest-est) et leurs alignements latéraux étaient organisés de manière à marquer les dates importantes du cycle agricole (et pas seulement les solstices ou les équinoxes). Šprajc (2021) confirme que les orientations des groupes E appartiennent à des « groupes d’alignement larges » liés aux préoccupations fondamentales de la société agricole plutôt qu’à des observations spécifiques. Dans la pratique, les axes des groupes E marquent le lever du soleil à des moments importants — par exemple, les intervalles de 143 jours entre le 2 mars et le 10 octobre — et ces intervalles correspondent aux travaux agricoles saisonniers.

Les études statistiques sur les orientations montrent que celles-ci ne se concentrent pas uniquement sur les équinoxes, mais qu’elles sont regroupées à des dates équidistantes liées aux 13 et 20 jours (périodes importantes du calendrier maya). En conséquence, les groupes E servaient de scènes rituelles représentant le calendrier solaire – un « théâtre » symbolique pour le cycle agricole plutôt qu’un instrument de mesure précis. Par exemple, à Uaxactún, Tikal ou Ceibal, on trouve des autels et des tombes alignés sur l’axe central des groupes E, tandis que les plates-formes latérales ont changé au fil du temps. Ainsi, le calendrier agricole maya « se concrétise dans la pierre » à travers des complexes urbains orientés de manière à organiser les rituels liés aux semailles et à l’année solaire.
- Études de cas : Uaxactún (Groupe E), Tikal (Monde perdu E), Ceibal (Centre), Chichén Itzá (Postclassique) en comparaison avec les modèles.
- Éléments à mesurer : Azimuts des axes (±0,25°), hauteur locale de l’horizon, dates solaires correspondantes, intervalles entre les dates (multiples de 13/20 jours).
- Méthodes : Mesures topographiques des axes architecturaux/LiDAR ; calculs du lever et du coucher du soleil en fonction de la latitude et de la durée d’utilisation ; analyse statistique des alignements en fonction du calendrier agricole.
Passages zénithaux et architecture lumineuse : Dans la région maya, les passages zénithaux du soleil (moment où le soleil est à son zénith, sans ombre, à midi) ont influencé la conception des ouvertures, des lucarnes et des agencements intérieurs. Des salles avec des puits de lumière verticaux ou des modifications des grottes permettant au soleil d’entrer à certaines heures de la journée ont été découvertes. Par exemple, à Monte Albán (bâtiment P) et à Teotihuacán, on trouve des traces de rayons solaires pénétrant dans des niches intérieures à des dates importantes, soutenues par l’orientation des bâtiments. Šprajc (2018) précise que l’observation du soleil zénithal n’était pas la « fonction principale » de ces espaces, mais l’une de leurs fonctions, la lumière pénétrant à l’intérieur lors de dates rituelles importantes.
La salle du Soleil à Palenque : À Palenque (Grupo de las Cruces), la tour du palais illustre ce principe. Anderson et al. (1981) ont documenté que le 12 août (quelques jours après le passage du zénith local), les rayons du soleil pénétraient verticalement par la fenêtre en forme de T du mur ouest sans projeter d’ombre sur le mur intérieur. Cela montre que l’ouverture était orientée avec une grande précision pour enregistrer les passages du zénith et du solstice. Ces « fenêtres zénitales » et les fenêtres hautes (comme celles situées au sommet des temples) fonctionnent comme des cadrans solaires intérieurs : en modélisant l’orbite du soleil à l’aide d’un logiciel 3D, on peut vérifier que la lumière directe du soleil atteint ces zones à des dates importantes et prolonge la période « sans ombre » de plusieurs minutes, voire plusieurs heures.
- Études de cas : Palenque (Tour du Palais, Groupe de la Croix), temples dotés de lucarnes ou de cheminées situés à divers endroits.
- Éléments à mesurer : hauteurs des ouvertures, diamètres des puits de lumière, angles d’incidence des rayons solaires pour les dates du zénith, durée d’éclairage direct dans les pièces intérieures.
- Méthodes : Simulations solaires (sens horaire) avec coupes architecturales ; enregistrement sur place de la pénétration de la lumière/des ombres dans les caméras intérieures.
Phénomènes solaires performatifs (rituels urbains) : L’architecture maya a « chorégraphié » des spectacles de lumière et d’ombre qui sont aujourd’hui devenus des rituels urbains. L’exemple le plus symbolique est la descente du serpent de lumière observée à la pyramide de Kukulkán (El Castillo) à Chichén Itzá. Au coucher du soleil lors de l’équinoxe, la lumière forme des triangles lumineux qui rappellent la queue d’un serpent mythologique. De même, à Dzibilchaltún (Yucatán), le Temple des Sept Enfants est traversé par le soleil de l’équinoxe, encadré par des fenêtres est-ouest, un phénomène très populaire dans les images de l’équinoxe. Ces effets donnent lieu à des défilés et à des rassemblements de masse dans les places et les voies cérémonielles (sacbeob) à des dates précises.
Cependant, des recherches récentes ont montré que ces événements ne sont pas directement liés à l’équinoxe et ne se limitent pas à une seule journée. Par exemple, à Dzibilchaltún, l’axe du temple est décalé d’environ 1° par rapport à l’est réel, de sorte que les photos « emblématiques » de l’équinoxe peuvent être prises quelques jours avant ou après. À Chichén Itzá/Mayapán, la série de triangles illuminés est observable pendant plusieurs semaines au moment des solstices et leur nombre varie. En résumé, les voyages et les rituels liés à la lumière (par exemple, la descente du dieu serpent en mars/septembre) organisent et confirment la fonction astronomique des bâtiments, mais les archéoastronomes soulignent que les solstices et les équinoxes ne sont pas nécessairement des dates fondamentales en Mésoamérique. Les directions indiquaient le lever/coucher du soleil à différentes dates agricoles et les effets de la lumière s’étendaient au-delà du temps réel. Ainsi, l’architecture urbaine transformait les événements solaires en spectacles civils, avec le passage du soleil sur les places et les sacbéob, mais leur signification rituelle était liée non seulement aux simulations astronomiques, mais aussi au calendrier agricole.
- Études de cas : Chichén Itzá (serpent Kukulkán), Dzibilchaltún (temple des sept bébés), Mayapán (effet similaire dans la pyramide nord), laboratoires de phénomènes lumineux ; places centrales de Uaxactún ou Tikal alignées sur le solstice d’été.
- Éléments à mesurer : Séries de photos changeant au fil du temps lors de journées importantes (rayons/ombres par minute) ; largeur et direction des faisceaux lumineux ; précision du cadrage dans les escaliers ; visibilité depuis le sacbé pour un large public.
- Observations critiques : Les recherches soulignent que les soi-disant « phénomènes d’équinoxe » peuvent se produire pendant cette période et qu’ils ne sont pas nécessairement spécifiques à la conception de l’équinoxe. L’importance sociale du soleil (« le temps du peuple ») se reflète dans les processions lumineuses organisées dans les places publiques et les temples, mais ces cérémonies sont interprétées en fonction du calendrier agricole et du pouvoir politique.
Hydraulique, climat saisonnier et urbanisme
Les Mayas ont organisé l’urbanisme en fonction des saisons climatiques et ont construit des infrastructures hydrauliques combinant approvisionnement en eau, politique et rituels. Dans les régions de plaine, où les pluies sont saisonnières et les hivers secs, les réservoirs, canaux et barrages étaient essentiels pour assurer l’approvisionnement en eau pendant les périodes de sécheresse. À Edzná (Campeche), par exemple, un système hydraulique complexe avait été conçu : 13 canaux principaux, 31 bras et 84 réservoirs irriguaient les terres agricoles en déversant l’eau de la vallée inondée dans un lac transformé en barrage. Ce système permettait de stocker l’eau de pluie, d’assécher les zones inondées et de développer une agriculture intensive.

La zéolite agit comme un filtre naturel pour l’eau potable. Des preuves importantes ont été trouvées à Tikal (Guatemala) : dans le réservoir de Corriental, on trouve un mélange stratigraphique de zéolite volcanique et de quartz naturel utilisé comme filtre pour l’eau potable. L’analyse XRD confirme que, entre 2200 et 1000 avant J.-C., l’eau était purifiée à l’aide de clinoptilolite et de mordenite (zéolithes) enfouies dans le filtre, ce qui en fait le plus ancien système de purification connu en Amérique. En fait, les Mayas ont importé du sable volcanique (quartz) et de la zéolite sur des dizaines de kilomètres pour construire ces filtres (le réservoir de Corriental avait une capacité d’environ 58 000 m³ et alimentait en eau des dizaines de milliers de personnes). En conséquence, aucune pollution ni mort d’algues n’a été observée dans les lits du Corriental, et les rois mayas ont légitimé leur pouvoir en construisant ces structures hydrauliques à côté de leurs palais et de leurs temples.
Intégration civile : Les structures hydrauliques servaient également de places publiques. À Caracol (Belize), les principaux réservoirs monumentaux étaient situés au bord des sacbés du centre-ville, sans obstacle à l’accès, ce qui indique que l’eau était gérée collectivement. Au fil du temps, des réservoirs d’eau domestiques ont fait leur apparition dans les quartiers, parallèlement aux réservoirs publics. De plus, les Mayas géraient la qualité de l’eau à l’aide de « zones humides artificielles » : ils y plantaient des plantes aquatiques (nénuphars, roseaux) qui filtraient les nutriments et oxygénaient l’eau. Ce système de rétention d’eau a fonctionné pendant plus de 1 000 ans, jusqu’à ce qu’il perde son efficacité en raison des sécheresses extrêmes des années 800-900.
- Études de cas : Tikal (réservoirs Corriental, filtration par zéolite), Edzná (canaux, barrage et lac artificiel), Caracol/Uxul (réseaux d’eau domestiques et publics).
- Éléments à mesurer : Volume utile des réservoirs (m³), zone de collecte d’eau et taux de renouvellement saisonniers, analyse XRD des sédiments filtrés, qualité microbiologique de l’eau dans le passé, relation spatiale avec les temples/palais.
- Applications actuelles : Les principes mayas sont réadoptés dans des pays comme le Mexique et le Pérou : Mérida/Campeche utilise des parcs de dépression et des bassins urbains pour stocker l’eau de pluie ; à Lima/Cusco, les cours de stockage d’eau et les « places éponges » qui atténuent les crues saisonnières des rivières refont leur apparition. Comme le souligne Lucero (2023), les techniques mayas de zones humides artificielles (plantes aquatiques, sédiments extractibles, remplissage naturel) offrent des enseignements précieux en matière de gestion durable de l’eau.

Cycles planétaires et vision citoyenne
Au cours de la période postclassique, l’observation de Vénus et de la Lune a pris une importance croissante dans l’architecture et les rituels. Associée à la guerre et à la divination, Vénus a commencé à être intégrée à grande échelle dans l’architecture. Par exemple, El Caracol (également connu sous le nom d’« observatoire ») à Chichén Itzá est une tour circulaire dotée de fenêtres stratégiquement placées. Des recherches ont montré que les fenêtres du deuxième étage indiquaient les azimuts des points extrêmes de Vénus au lever et au coucher du soleil. Sur la façade, on trouve des reliefs liés à la position de Vénus et des figures à tête de serpent à plumes avec un disque sur lequel est inscrit le glyphe « K’uk’ Ek’ » (« étoile quetzal », Vénus). Tout indique que l’observation de Vénus à Chichén Itzá confirmait l’avènement de Kukulkán en tant que véritable dieu. Les inscriptions mayas mentionnent également le site « K’uk’ Ek » à Palenque, associé à un rituel lié à Vénus. Ces alignements reflètent le cycle synodique de Vénus (584 jours) documenté dans le Tableau de Vénus du Codex de Dresde.
- Études de cas : El Caracol (Chichén Itzá), Mayapán et Palenque, inscriptions épigraphiques.
- Éléments à mesurer : angle de vision par rapport aux positions maximales/minimales de Vénus et aux points extrêmes de la lune, fréquence d’apparition (tous les 8 ans, cycles de 18,6 ans, cycle lunaire), intervalles d’observation.
- Méthodes : reconstitution des alignements des fenêtres et des fentes à l’aide d’un logiciel de simulation, corrélation avec les dates et les cycles lunaires du Codex de Dresde (Tableau de Vénus), analyses des reliefs et de l’iconographie associés.

Dans l’ensemble, cette situation évoque un concept complémentaire de « temps civil » : les Mayas avaient intégré les rythmes des planètes dans la sphère publique. Alors que les calendriers solaires déterminaient l’agriculture, Vénus déterminait les rythmes guerriers et rituels (par exemple, chez les Mayas, les tensions militaires augmentaient tous les huit ans, parallèlement à l’apparition de Vénus). Cette approche propose un urbanisme qui intègre le cosmos à la politique. La leçon à retenir aujourd’hui est que, outre les cycles climatiques annuels (soleil et pluie), les sociétés peuvent développer des projets collectifs en fonction de modèles astronomiques plus larges.
En savoir plus sur Dök Architecture
Subscribe to get the latest posts sent to your email.